Rapport de durabilité : ce que votre direction attend vraiment de vous en 2025
21-07-2025 - par Célestine Moreira
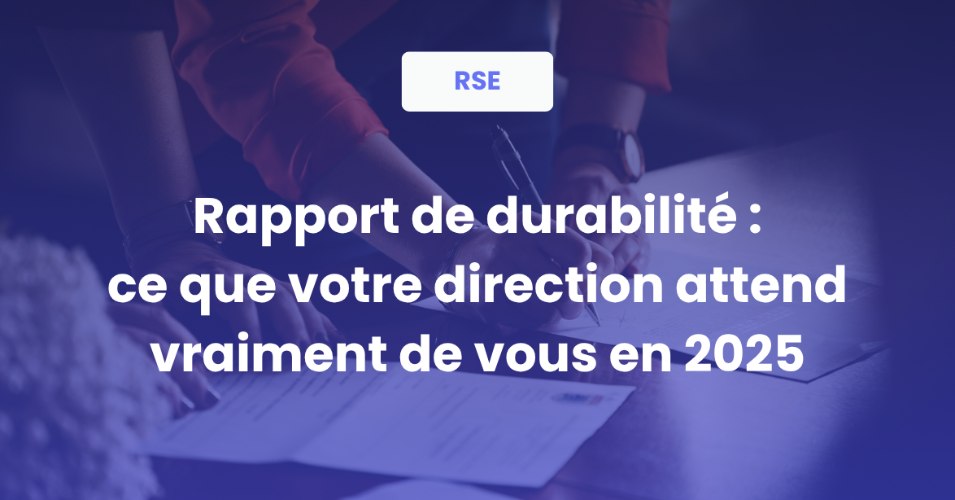
Le rapport de durabilité n’est plus un exercice isolé
Le rapport de durabilité ne relève plus uniquement de la fonction RSE au sein des entreprises. Il devient un outil de pilotage partagé, dans lequel la direction générale, la direction financière, les RH, les achats ou encore la direction juridique ont toutes un rôle à jouer, à leur niveau.
1. Les attentes internes montent
Ce n’est un secret pour personne : la loi Omnibus a profondément redéfini le périmètre d’application du rapport de durabilité au format de la directive CSRD. Désormais, seules les entreprises de plus de plus 1000 salariés sont directement concernées par cette obligation (sauf revirement à l’automne 20225). Mais dans les faits, cette évolution n’a pas allégé les attentes autour du reporting ESG pour les autres entreprises. Au contraire, même les entreprises non soumises à la directive CSRD sont de plus en plus mobilisées en interne pour produire des données ESG structurées, exploitables et crédibles.
La raison est simple : les autres directions de l’entreprise ont besoin de ces informations pour avancer. La direction générale, en particulier, cherche à éclairer ses décisions stratégiques à la lumière des enjeux environnementaux et sociaux : diversification, alignement à une trajectoire bas carbone, réponse aux attentes des parties prenantes….
Côté direction financière, la question est celle de l’allocation des ressources : où investir, quels projets arbitrer, comment justifier certains choix face à des critères de performance extra-financière de l'entreprise.
Du côté des ressources humaines, les informations issues du reporting ESG deviennent précieuses pour affirmer une politique RH plus responsable, crédible face aux talents, et alignée avec les nouvelles attentes sociétales.
Les directions achats, elles, s’appuient de plus en plus sur ces informations pour mettre en œuvre une politique d’achats responsables cohérente, sélectionner des fournisseurs engagés ou répondre à des exigences clients croissantes.
Et même les directions juridiques s’y intéressent de près, que ce soit pour vérifier la conformité avec d’autres textes réglementaires et normes (devoir de vigilance, loi AGEC, taxonomie...) ou pour sécuriser les engagements publics de l’entreprise et prévenir tout risque de greenwashing.
En clair, le rapport de durabilité ne sert plus seulement à “cocher une case réglementaire” : il alimente désormais le fonctionnement stratégique quotidien des entreprises. Et cette réalité dépasse largement les seuils imposés par la réglementation.
2. Et les pressions externes suivent
L’enjeu ne se limite pas aux attentes internes. Les pressions externes, elles aussi, s’intensifient et redéfinissent le rôle du rapport de durabilité dans la relation avec l’écosystème de l’entreprise.
Du côté des clients grands comptes, la tendance est claire : les critères ESG deviennent des critères de sélection à part entière. Certaines clauses sont désormais intégrées dans les contrats-cadres, avec des exigences précises sur le reporting, la traçabilité des actions ou la performance carbone. Et ce qui relevait hier de la “bonne volonté” devient aujourd’hui un critère de référencement.
Les investisseurs, même pour des montants modestes ou des structures non cotées, demandent eux aussi des garanties : cohérence de la trajectoire climatique, politique sociale, gouvernance des engagements... Les banques ne sont pas en reste : l’accès à certains financements est de plus en plus conditionné à des preuves de performance extra-financière, qu’il s’agisse de prêts classiques aux entreprises ou de financements verts.
Les appels d’offres, qu’ils soient publics ou privés, exigent désormais des éléments concrets. Les déclarations générales ne suffisent plus : les entreprises doivent montrer des résultats, des indicateurs suivis d’année en année, des plans d’action crédibles et datés.
Dans ce contexte le rapport de durabilité ne relève plus de la simple formalité, même pour une PME ou une ETI. Il devient un outil stratégique, un levier pour se démarquer, sécuriser un financement ou remporter un contrat. En résumé, c’est désormais un outil de compétitivité à part entière.
Connectez vos données ESG à votre écosystème avec Zei
Les 5 attentes des directions générales pour le rapport de durabilité
Le rapport de durabilité n’est plus perçu comme un simple exercice réglementaire ou un livrable uniquement RSE. Pour la direction générale, il devient un outil stratégique à part entière, un document qu’on consulte, qu’on utilise, et sur lequel on s’appuie pour décider. En 2025, cinq attentes clés émergent dans la majorité des entreprises, même celles non soumises à la directive CSRD.
1. Des preuves d’engagement, pas des déclarations d’intention
Annoncer un objectif “Net Zéro 2050” ou se revendiquer “entreprise durable” sans preuves tangibles d’avancement revient à produire un discours creux, voire contre-productif. Ce que la direction veut désormais, ce sont des faits : des actions concrètes engagées cette année, des résultats chiffrés, des investissements réalisés, une gouvernance clarifiée, et une feuille de route précise pour les douze prochains mois.
Ce niveau de transparence est essentiel pour crédibiliser les engagements pris. Il ne s’agit pas seulement de se raconter une histoire, mais de démontrer des progrès réels, avec leurs limites, leurs difficultés et leurs arbitrages. Un bon rapport de durabilité doit assumer une forme d’honnêteté opérationnelle : ce qui avance, ce qui coince, et ce qui est prévu pour améliorer la situation.
2. Des données lisibles et fiables, exploitables dans les arbitrages internes
La direction ne lit pas un rapport de durabilité pour se rassurer : elle le lit pour agir. Or, un reporting qui ne repose pas sur des données solides n’aura aucun poids dans les arbitrages internes. Aujourd’hui, les indicateurs ESG sont mobilisés pour justifier un investissement, prioriser un projet ou arbitrer entre deux options stratégiques.
Cela suppose d’abord que les informations utilisées soient fiables : issues de sources traçables, collectées selon une méthodologie claire, consolidées et vérifiées grâce à des documents justificatifs. Ensuite, qu’elles soient lisibles : présentées dans des formats clairs (gaphiques, infographies…), avec des ordres de grandeur compréhensibles, synthétiques, faciles à comparer à d’autres postes de pilotage. Enfin, elles doivent être comparables : d’une année sur l’autre, mais aussi par rapport aux standards et moyennes du secteur.
3. Un lien clair entre enjeux ESG et stratégie d’entreprise
La direction générale ne veut pas d’un reporting parallèle à la stratégie, mais d’un document qui s’y articule. Elle attend qu’on lui montre en quoi les enjeux ESG affectent les résultats de l’entreprise : sur les coûts, les risques, les opportunités. Il ne s’agit pas simplement d’identifier les externalités, mais de les intégrer à la réflexion stratégique.
En 2025, un bon rapport de durabilité montre en quoi les enjeux ESG influencent les décisions de développement, d’investissement ou d’innovation sur des sujets de transformation : dépendance énergétique, adaptation à la réglementation, attentes des talents et consommateurs, évolution des chaînes de valeur…
Ce lien stratégique est indispensable pour que la direction s’approprie le contenu du reporting. Il ne s’agit pas de vulgariser, mais de traduire les sujets ESG dans un langage orienté “business”, sans édulcorer leur importance.
4. Une prise en compte de la chaîne de valeur
La direction générale s’intéresse de plus en plus aux impacts indirects. Ce que l’entreprise ne maîtrise pas directement devient pourtant un enjeu critique : émissions carbone de ses fournisseurs, pratiques sociales chez ses sous-traitants, dépendance à des ressources vulnérables…
En clair, on ne peut plus limiter le rapport de durabilité au seul périmètre opérationnel. Il faut y intégrer la chaîne de valeur. Cela passe par la mesure du scope 3, mais aussi par une politique d’achats responsables, des critères ESG intégrés dans la sélection des fournisseurs, des engagements co-construits avec l’écosystème.
Même si une entreprise n’est pas soumise à la directive CSRD, elle est peut-être fournisseur d’un groupe qui l’est. Dans ce cas, ses propres engagements conditionnent sa place dans cette chaîne. Pour la direction, cela devient une priorité commerciale autant qu’éthique.
Évaluez votre chaîne de valeur sur Zei
5. Un livrable professionnel : rigoureux, synthétique, crédible
Un bon fond ne suffit pas. Le rapport de durabilité est un document lu et partagé. Il doit donc être irréprochable sur la forme. Les directions ne tolèrent plus les rapports désordonnés, verbeux ou approximatifs. Elles attendent un document clair, structuré, lisible et qui inspire confiance.
Cela suppose une écriture précise, sans jargon technique superflu, une hiérarchisation rigoureuse des sujets, un design sobre, qui facilite la lecture rapide. Et surtout, une transparence méthodologique : comment les données ont-elles été produites ? Quels indicateurs ont été retenus ? Quelles sont les limites de l’analyse ?
En somme, le rapport doit être assumable. Assumable devant un client, un investisseur, une direction juridique. Il doit pouvoir circuler sans qu’on ait besoin de l’expliquer. Pour cela, il faut le penser comme un outil de crédibilité, à la hauteur des enjeux qu’il porte.
Comment structurer votre rapport pour répondre à ces attentes
Une fois que vous avez bien compris les attentes de votre direction générale, il faut adapter les rapports de durabilité en fonction de ces attentes. Trop de rapports de durabilité bien intentionnés restent parfois encore au stade du catalogue d’initiatives sans orientation stratégique claire. Voici cinq leviers concrets pour construire un rapport de durabilité qui parle aux décideurs.
Découvrez notre guide complet sur la performance RSE
1. Construire autour des grandes questions stratégiques
Un bon rapport de durabilité commence par faire des choix. Plutôt que de dérouler tous les indicateurs disponibles, concentrez votre narration autour de quelques informations structurantes pour l’entreprise : la trajectoire carbone, la maîtrise des risques fournisseurs, l’attractivité RH, la conformité réglementaire, la transformation des modèles économiques… Ces sujets doivent être identifiés en lien avec l’analyse de double matérialité et intégrés dès l’introduction comme étant les fils rouges du reporting.
2. Aligner le rapport sur les besoins concrets de la direction
Posez-vous une question simple : à quoi va servir ce rapport, concrètement, pour ma direction ? Recruter des talents ? Justifier un investissement dans un projet à impact ? Répondre à un appel d’offres exigeant sur les critères ESG ? Obtenir un financement bancaire ? Convaincre un comité stratégique ?
Ce n’est pas au rapport de se suffire à lui-même, c’est à lui de servir ces objectifs. Si votre direction ne peut pas s’appuyer sur ce document dans ses échanges opérationnels ou stratégiques, vous passez à côté de sa vraie valeur. Il faut donc penser le contenu comme un outil d’aide à la décision, et non comme un simple exercice de conformité.
3. Soigner la clarté, la synthèse, la lisibilité
Votre direction est souvent sur-sollicitée. Elle lit vite, saute des pages, cherche des données clés. Si votre rapport est trop dense, trop technique, ou mal structuré, il risque d’être survolé. Pour éviter cela, il faut adopter une écriture synthétique, des titres explicites, des résumés exécutifs utiles, des infographies bien conçues, des informations clés bien mises en valeur.
En clair, il faut que le rapport de durabilité permette à une personne qui n’a pas participé au processus de reporting de comprendre ce qui a été fait, ce qui reste à faire, et comment cela s’intègre dans la stratégie globale de l’entreprise.
4. Éditer plusieurs versions du rapport selon les interlocuteurs
Un reporting unique pour tous les publics, c’est rarement une bonne idée. Même si la base reste la même, il est pertinent de produire plusieurs formats ou déclinaisons : un reporting complet pour les parties prenantes exigeantes, un résumé stratégique pour le COMEX ou le board, une présentation synthétique pour les commerciaux ou les RH, un document “preuve” pour répondre aux appels d’offres…
Cette logique de déclinaisons d’un même rapport de durabilité vous permet de mieux valoriser votre travail, en l’adaptant aux besoins réels des interlocuteurs. Vous gagnez en efficacité, en crédibilité, et vous évitez l’effet “pavé PDF” que personne ne lit en entier.
5. Créer un rapport transversal avec les autres directions
Le rapport de durabilité ne doit pas être un objet RSE isolé. Il gagne en force lorsqu’il s’appuie sur les enjeux et les priorités d’autres directions : RH, finance, achats, juridique, direction générale. En intégrant leurs indicateurs, leurs plans d’action, leurs contraintes, vous créez un document fédérateur : utile pour chacun, légitime pour tous.
Cela suppose un travail en amont : identifier les points de contact entre la stratégie ESG et les autres politiques de l’entreprise. C’est ce travail d’intégration qui donne au rapport de durabilité un nouveau statut : celui d’un outil collectif de pilotage.
