CSRD : zoom sur l’ESRS 1
27-03-2025 - par Célestine Moreira
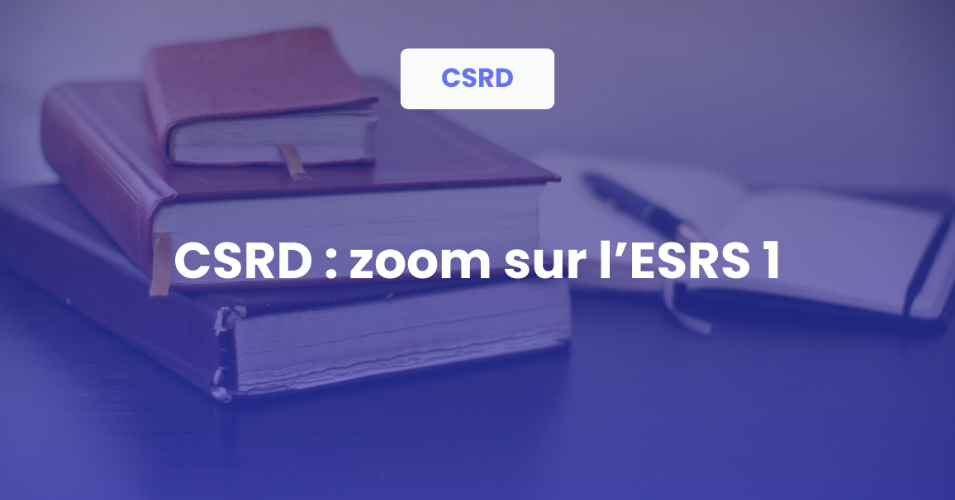
ESRS 1 : les principes généraux du reporting de durabilité
Le rôle de l’ESRS 1 est de poser les bases méthodologiques du reporting de durabilité. Cette norme dite “transversale” définit en détail les principes généraux applicables à chaque entreprise concernée par la CSRD, quelle que soit sa taille ou son secteur. La norme ESRS 1 assure également la cohérence du reporting de la CSRD avec les autres référentiels internationaux comme le GRI (Global Reporting Initiative), le SASB (Sustainability Accounting Standards Board) ou le TCFD (Task Force on Climate Related Financial Disclosures). En revanche, la norme ESRS 1 n’est là que pour poser une structure, un cadre méthodologique. Son rôle n’est pas, contrairement aux autres normes ESRS dites “thématiques” (la norme ESRS 2 puis les normes ESRS E, ESRS S et ESRS G), de lister les indicateurs et points de données et informations demandés pour le reporting.
Le principe de double matérialité
La double matérialité est un des principes fondateurs de la CSRD, et la norme ESRS 1 a pour rôle de l’expliquer et d’en définir la méthodologie. La double matérialité aide les entreprises concernées par la CSRD a définir sur quelles normes ESRS thématiques se concentrer. Elles doivent donc évaluer, à l’aide d’une méthodologie précise, lesquels sont pertinents pour leur activité. La norme ESRS 1 détaille les deux faces de la double matérialité de la manière suivante.
La matérialité d’impact (aussi appelée “Inside-Out”)
C’est l’aspect qui vient à l’esprit de la majorité des personnes lorsqu’on parle de durabilité pour les entreprises. Cette facette de la double matérialité évalue comment les activités de l'entreprise influencent le changement climatique et la société. Par exemple, cela peut inclure les émissions de carbone, le respect du doit du travail ou les impacts sur la biodiversité et le populations locales.
Voici quelques exemples concrets qui peuvent être pris en compte dans la matérialité d'impact :
- les émissions de gaz à effet de serre d'une usine de fabrication d'aluminium
- le choix d'un fournisseur d'électricité verte pour des bureaux
- le travail illégal d'enfants dans des usines de sous-traitants de marques textiles
- la mise en place de politiques anti-corruptions dans le domaine bancaire
La matérialité financière (aussi appelée “Outside-In”)
Contrairement à la matérialité d’impact, cette facette de la double matérialité n’est pas aussi évidente dans l’esprit collectif. La matérialité financière a pour but d’évaluer comment le changement climatique et les évolutions sociales vont impacter l’activité et la pérennité de l’entreprise. La matérialité financière peut comprendre à la fois des risques ou des opportunités. Cela induit donc que le changement climatique ou les évolutions sociales peuvent mettre en péril l'entreprise, mais également lui ouvrir des portes représentant des opportunités durables et financières.
Voici quelques exemples concrets qui peuvent être pris en compte dans la matérialité financière :
- l'assèchement des sols pour une entreprise agro-alimentaire
- la montée des eaux lors de l'achat d'un nouveau bâtiment qui sera en zone inondable dans 10 ans
- le développement de nouvelles technologies permettant de développer un produit plus durable
Une fois ces deux aspects évalués, les entreprises concernées par la CSRD se retrouvent donc avec des normes ESRS et indicateurs considérés comme “matériels” ou “non matériels”, justifiant ainsi de la pertinence des indicateurs qu’elles vont utiliser pour leur rapport de durabilité. Sur cette base, elles peuvent donc commencer la collecte des données ESG pour leur reporting CSRD.
Facilitez votre double matérialité avec notre outil dédié
Le champ d’application de la CSRD et le périmètre de reporting
Un des rôles de la norme ESRS 1 est également de définir clairement tout ce que les entreprises concernées par la CSRD doivent prendre en compte dans leur rapport de durabilité. Là où d’autres réglementations ou recommandations se concentraient surtout sur les activités internes de l’entreprise, la CSRD adopte une approche plus globale et complète, incluant donc la totalité de la chaîne de valeur des entreprises.
Ainsi, pour leur rapport de durabilité, les entreprises concernées par la CSRD doivent tout d’abord prendre en compte toutes leurs activités. Cela inclut donc :
- Les filiales, ainsi que les autres entreprises qui sont sous le contrôle de l’entreprise principale
- Les joint-ventures et les entreprises en partenariat stratégique, en fonction du degré de contrôle que l’entreprise a sur ces entreprises
Les entreprises qui doivent publier leur rapport de durabilité doivent également prendre en compte la totalité de leur chaîne de valeur, incluant donc les sociétés intervenant en amont ou en aval de leurs activités. Cela inclut donc :
- Les fournisseurs et les sous-traitants, particulièrement les entreprises qui ont un fort impact sur les activités de l’entreprise
- Les distributeurs et les clients, car leurs pratiques et choix RSE peuvent également influencer leurs impacts ESG
- Les prestataires, notamment les transporteurs qui peuvent générer des émissions des gaz à effet de serre importants pour le scope 3 de l’entreprise concernée
Ces données et informations au global doivent être collectées et consolidées pour être, par la suite, intégrées au rapport de durabilité de l’entreprise. Pour mener à bien ce projet, il est fortement conseillé d’utiliser un outil dédié qui intègre la consolidation, comme Zei.
Testez l'outil de collecte Zei gratuitement
La structure et la présentation des données ESG pour la CSRD
Le rôle de la norme ESRS 1 est également de spécifier comment les données et informations doivent être représentées dans le rapport de durabilité final. L’objectif d’avoir une structuration bien définie est d’assurer la comparabilité entre les entreprises et un maximum de transparence pour réduire les risques de greenwashing.
Présenter les données et les informations de façon homogène
La principale exigence impose que les entreprises publient leurs données ESG et informations de durabilité dans un format homogène et commun. Ainsi, chaque information soit apparaître dans des sections et catégories dédiées et dans les normes ESRS thématiques correspondantes.
Les indicateurs utilisés pour les données quantitatives ou semi-narratives doivent également être les mêmes pour toutes les entreprises, pour permettre aux parties prenantes de comparer facilement les sociétés entre elles. Ainsi, en évitant qu’une société comptabilise ses émissions de gaz à effet de serre en TeqCO2 et qu’une autre les comptabilise en kg, la donnée est immédiatement comparable, sans besoin de faire de calculs intermédiaires.
Testez les calculs automatiques de Zei gratuitement
Le tagging XBRL pour la CSRD
Un des autres aspects de la présentation des informations pour le rapport de durabilité est la taxonomie et le tagging des différents points de données. La normes ESRS 1 impose que le rapport de durabilité soit lisible par les humains et les machines. Pour satisfaire cette deuxième exigence, l’EFRAG a précisé quelques mois après la publication de la CSRD quel format devra être utilisé pour les machines. Il s’agit du format XBRL, déjà utilisé dans d’autres reportings financiers européens.
En résumé, voici à quoi sert le format XBRL en matière de reporting extra-financier :
- Le tagging XBRL permet également de tagger des informations textuelles et chiffrées de façon à ce qu’elles puissent être lues par un ordinateur. Cette fonction est particulièrement importante dans le cadre de la CSRD, pour pouvoir analyser et comparer la même information chez plusieurs entreprises automatiquement et les implanter dans les futurs comparateurs “Yuka de la RSE”.
- Le tagging XBRL permet également de limiter les risques de greenwashing. Chaque point de donnée doit être taggé selon une taxonomie précise et complète, obligeant les entreprises à être plus transparentes et empêchant donc les biais d’interprétation.
- Il est déjà utilisé pour le reporting financier, notamment l’ESEF, la SEC, ou la règlementation Solvabilité II. Il permet donc de s’intégrer facilement aux autres systèmes financiers existants, et de ne pas ajouter un nouveau format pour les entreprises.
Le principe de devoir de vigilance (ou “due diligence”) dans la CSRD
Un des autres rôles de la norme ESRS 1 est d’établir des règles précises concernant le devoir de vigilance (ou “due diligence”) et la gestion des risques liés aux enjeux ESG dans le rapport de durabilité. Les entreprises doivent expliquer clairement comment elles identifient et évaluent les risques ESG, et ce, sur toute leur chaîne de valeur.
Les entreprises soumises à la CSRD doivent donc prendre en compte leurs propres activités, mais aussi celles de leurs fournisseurs, sous-traitants, partenaires commerciaux et financiers... Pour cela, ces sociétés doivent mettre en place un réel processus de surveillance et d’analyse pour leur permettre de détecter et donc anticiper au mieux les impacts négatifs potentiels sur le changement climatique et la société. La norme ESRS 1 leur impose également de détailler des mesures préventives pour réduire les risques qui auront été identifiés, ainsi que les actions visant à réparer les impacts en cas d’incident.
La gouvernance joue un rôle clé dans le devoir de vigilance : les entreprises doivent préciser quelle est la répartition des responsabilités en matière de durabilité, de l’intégration des enjeux ESG dans la stratégie globale et les mécanismes de contrôle qui garantissent la fiabilité des informations rapportées. Grâce à ces exigences, l’ESRS 1 permet de renforcer la transparence et surtout la gestion proactive des risques ESG, pour qu’ils ne soient pas qu’une case réglementaire à cocher dans la liste des équipes RSE et Finance.
En conclusion, l’ESRS 1 est la pierre angulaire du rapport de durabilité. Cette norme définit les principes méthodologiques fondamentaux de la CSRD, structure l’approche autour de la double matérialité, de l’intégration de l’ensemble de la chaîne de valeur et de la transparence des données et informations ESG. Ainsi, l’ESRS 1 garantit une harmonisation du reporting de la CSRD entre les entreprises et une meilleure comparabilité des performances extra-financières de ces sociétés. Avec la norme ESRS 1, la CSRD ne se limite pas à une contrainte réglementaire mais qu'elle ouvre des opportunités : elle devient un levier stratégique, incitant les entreprises à structurer leur démarche ESG pour mieux répondre aux attentes des investisseurs, des clients et des régulateurs, et ainsi devenir actrices du changement.
