GES : définition, exemples et rôle dans le changement climatique
09-07-2025 - par Célestine Moreira
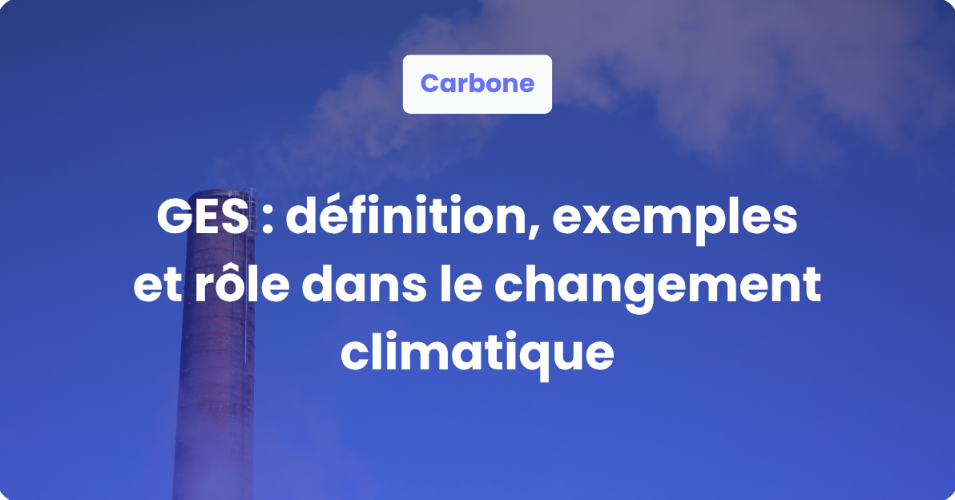
GES : de quoi parle-t-on concrètement ?
Qu’est-ce qu’un GES ?
Un gaz à effet de serre (GES) est un gaz présent dans l’atmosphère qui a la capacité de retenir une partie de la chaleur émise par la surface terrestre. Ce phénomène est naturel et même vital : sans effet de serre, la température moyenne sur Terre serait d’environ -18°C, incompatible avec la vie terrestre. Grâce aux GES et à l’effet de serre, nous bénéficions d’un climat relativement stable et habitable.
Mais depuis le début de l’ère industrielle, la concentration de ces gaz a fortement augmenté, principalement à cause des activités humaines. Résultat : l’effet de serre s’emballe, et la température moyenne mondiale grimpe. C’est ce qu’on appelle l’effet de serre amplifié, moteur principal du changement climatique.
Quels sont les GES concernés ?
Le Protocole de Kyoto, signé en 1997 et entré en vigueur en 2005, est l’un des premiers accords internationaux à avoir encadré la réduction des émissions de GES. Il identifie six gaz à effet de serre majeurs :
- CO₂ (dioxyde de carbone)
- CH₄ (méthane)
- N₂O (protoxyde d’azote)
- HFC (hydrofluorocarbures), PFC (perfluorocarbures), SF₆ (hexafluorure de soufre)
Chaque gaz n’a pas le même pouvoir de réchauffement. Pour les comparer, on utilise leur équivalent CO₂ (écrit éqCO₂), qui exprime leur potentiel de réchauffement global (PRG) sur 100 ans. Voici quelques repères :
| Gaz | PRG sur 100 ans (éqCO₂) |
| CO₂ | 1 |
| CH₄ | 28 à 34 |
| N₂O | 265 à 298 |
| HFC | 140 à plus de 12 000 |
| PFC | jusqu’à 12 000 |
| SF₆ | environ 23 500 |
Autrement dit, 1 tonne de SF₆ équivaut à plus de 23 000 tonnes de CO₂ en termes d’impact climatique. Ces gaz, bien que souvent moins émis que le CO₂, sont donc beaucoup plus efficaces pour piéger la chaleur.
D’où proviennent les principaux GES ?
Le dioxyde de carbone (CO₂) : le gaz le plus émis
Le CO₂ représente à lui seul plus des trois quarts des émissions mondiales de GES. Il provient principalement de la combustion d’énergies fossiles (charbon, pétrole, gaz) utilisées pour produire de l’électricité, faire rouler nos véhicules, chauffer nos bâtiments ou alimenter les usines.
Voici les principaux secteurs émetteurs :
- Les transports (routiers, aériens, maritimes) : ils fonctionnent encore largement avec des carburants fossiles. En France, ils représentent la première source d’émissions de CO₂, notamment à cause de la voiture individuelle.
- La production d’électricité : au niveau mondial, elle reste majoritairement fossile (charbon et gaz), même si la France bénéficie d’un mix électrique très décarboné (nucléaire + hydraulique).
- Les bâtiments : le chauffage au gaz, au fioul ou au charbon est encore courant, surtout dans le parc ancien.
- L’industrie lourde (ciment, acier, verre, chimie) : ces secteurs émettent à la fois du CO₂ par combustion d’énergie et par réactions chimiques (comme la calcination du calcaire dans la fabrication du ciment).
Le CO₂ peut également être émis indirectement, par la déforestation. Lorsqu’on abat un arbre, on libère le carbone qu’il stockait, et on réduit sa capacité à absorber du CO₂.
Le méthane (CH₄) : un gaz sous-estimé mais très puissant
Le méthane est responsable d’environ 125% du réchauffement climatique actuel, bien qu’émis en moindre quantité que le CO₂. Son pouvoir de réchauffement est environ 30 fois plus élevé que celui du CO₂, sur une période de 100 ans.
Ses principales sources sont :
- L’agriculture (à elle seule responsable d’environ 40% des émissions mondiales de CH₄) :
- La digestion des ruminants (vaches, moutons…) émet du méthane par fermentation entérique.
- Les rizières inondées produisent du méthane en condition anaérobie.
- Les déchets : dans les décharges, les matières organiques (restes alimentaires, déchets verts) se décomposent sans oxygène et libèrent du CH₄.
- L’énergie : les extractions de gaz naturel, les fuites dans les pipelines, ou les torchages lors de l’exploitation pétrolière libèrent d’importantes quantités de méthane, souvent sous-évaluées.
Réduire les émissions de méthane est une priorité climatique à court terme : comme il reste moins longtemps dans l’atmosphère que le CO₂, son impact sur le réchauffement est plus intense mais plus rapide à limiter si on agit maintenant.
Le protoxyde d’azote (N₂O) : le gaz discret de l’agriculture
Le protoxyde d’azote, ou gaz hilarant, est un puissant GES (près de 300 fois plus réchauffant que le CO₂) et reste dans l’atmosphère pendant plus de 100 ans.
Il provient principalement de l’utilisation d’engrais azotés dans l’agriculture :
- Lorsque les sols reçoivent plus d’azote que les plantes ne peuvent en absorber, une partie est transformée en N₂O par des bactéries du sol.
- Ce phénomène est accentué par la fertilisation excessive, les épandages mal gérés, ou les sols humides.
D’autres sources incluent :
- Certains procédés industriels, notamment dans la fabrication de l’acide nitrique ou de l’adipate (utilisé pour les plastiques).
- L’usage de N₂O comme gaz anesthésiant, bien que marginal à l’échelle globale.
Ce gaz est souvent absent des radars grand public, mais il est en forte hausse depuis plusieurs décennies, en lien avec l’industrialisation de l’agriculture.
Les gaz fluorés : des impacts climatiques démesurés
Les gaz fluorés (HFC, PFC, SF₆…) sont utilisés pour leurs propriétés physico-chimiques : inertie, faible conductivité thermique, stabilité. On les retrouve dans :
- Les réfrigérateurs, congélateurs et climatiseurs (HFC) ;
- Les isolants thermiques dans le bâtiment ;
- Certaines applications industrielles de niche, comme les équipements électriques haute tension (SF₆) ou la microélectronique.
De nombreux gaz fluorés sont désormais progressivement interdits ou remplacés par des alternatives moins nocives, via des réglementations internationales comme l’amendement de Kigali au protocole de Montréal.
Faites votre bilan GES sur Zei
Le rôle des GES dans le réchauffement climatique
Des conséquences déjà bien visibles
Ce réchauffement global de +1,2 °C en moyenne depuis la fin du 19e siècle n’est pas une projection théorique. Ses effets sont déjà visibles, partout dans le monde :
- Fonte des glaciers et des calottes polaires, avec pour conséquence une montée du niveau des mers
- Événements climatiques extrêmes plus fréquents et plus intenses : canicules, sécheresses, inondations, incendies…
- Perturbation des écosystèmes : migrations d’espèces, effondrement de la biodiversité, risques pour la sécurité alimentaire
- Impact sur la santé humaine, la ressource en eau, les rendements agricoles, ou encore les infrastructures
Ces phénomènes sont largement amplifiés par les GES d’origine anthropique, comme le montre l’ensemble des travaux scientifiques récents. Le rapport du GIEC de 2023 est sans équivoque : les émissions de GES sont la principale cause du changement climatique actuel.
L’urgence d’agir
Le défi est d’autant plus grand que le climat fonctionne avec une forte inertie. Une fois émis, certains GES (comme le CO₂ ou le N₂O) peuvent rester plus d’un siècle dans l’atmosphère, continuant à influer sur le climat longtemps après leur émission. Cela signifie que même en réduisant drastiquement nos émissions aujourd’hui, le réchauffement se poursuivra encore plusieurs décennies.
C’est pourquoi les scientifiques et les décideurs s’accordent sur des seuils à ne pas franchir : limiter le réchauffement à +1,5 °C, voire à +2 °C maximum par rapport à l’ère préindustrielle. Au-delà, les conséquences deviennent largement incontrôlables, avec des effets systémiques sur la sécurité mondiale.
Ces limites sont au cœur de l’Accord de Paris, signé en 2015 par 195 pays, qui vise à :
- Réduire drastiquement les émissions mondiales de GES
- Atteindre la neutralité carbone d’ici 2050 pour les pays les plus émetteurs
- Soutenir les pays les plus vulnérables face aux effets du changement climatique
À l’échelle nationale, ces objectifs se traduisent par des stratégies climat (comme la SNBC en France) et des réglementations de plus en plus structurantes pour les entreprises (CSRD, taxe carbone, reporting extra-financier…).
Comment mesurer ses émissions de GES ?
Le principe du bilan GES
Il est impossible de réduire efficacement ses émissions de GES sans savoir exactement d’où elles viennent. C’est tout l’enjeu du bilan carbone (aussi appelé bilan GES ou BEGES). C’est un outil de comptabilité carbone qui permet à une entreprise, une collectivité ou un territoire de mesurer l’ensemble de ses émissions de gaz à effet de serre sur une période donnée.
L’objectif du bilan carbone est d’obtenir une cartographie claire de son empreinte carbone, ce qui permettra ensuite de définir les actions de réduction ciblées le plus pertinentes.
Le principe du bilan GES repose sur trois grandes étapes :
- Collecter les données d’activité : consommation d’énergie (électricité, gaz, carburants…), déplacements professionnels, fret, achats, production de déchets…
- Appliquer des facteurs d’émission à ces données : un facteur d’émission est un coefficient qui permet de convertir une unité physique (kWh, km parcouru, kg acheté…) en tonnes équivalent CO₂ (tCO₂e)
- Analyser les résultats pour repérer les postes les plus émetteurs et donc les plus stratégiques à décarboner
Il ne s’agit pas d’un simple exercice théorique, les données doivent être précises en s’appuyant sur des factures, des relevés, des données RH, logistiques ou comptables. Plus la donnée est fiable, plus le plan d’action sera pertinent.
Faites votre bilan GES sur Zei
Le rôle des GES dans le réchauffement climatique
Les 3 scopes du bilan GES
Pour structurer cette comptabilité carbone, la plupart des méthodologies s’accordent à diviser les émissions en trois catégrories, aussi appelées “scopes”.
- Scope 1 (émissions directes) : ce sont les émissions de GES produites directement par l’organisation, par exemple via la combustion de carburant dans les véhicules de service qu’elle possède.
- Scope 2 (émissions indirectes liées à l’énergie) : ce sont les émissions de GES associées à la production de l’électricité, de la chaleur ou de la vapeur achetée par l’entreprise. Même si l’entreprise ne les émet pas directement, elle en est responsable par sa consommation et son choix de fournisseur d’énergie.
- Scope 3 (autres émissions indirectes) : ce sont toutes les autres émissions de GES indirectes. Cela peut concerne toute la chaîne de valeur en amont et en aval, par exemple les achats de matières premières, le transport des marchandises, les déplacements domicile-travail, l’usage des produits vendus, la fin de vie des équipements…
Pour une grande partie des entreprises, le scope 3 représente entre 70 % et 90 % de l’empreinte carbone totale. C’est aussi le scope le plus complexe à mesurer, car il dépend souvent de données externes (fournisseurs, clients, partenaires…), pas toujours faciles à collecter et mesurer.
